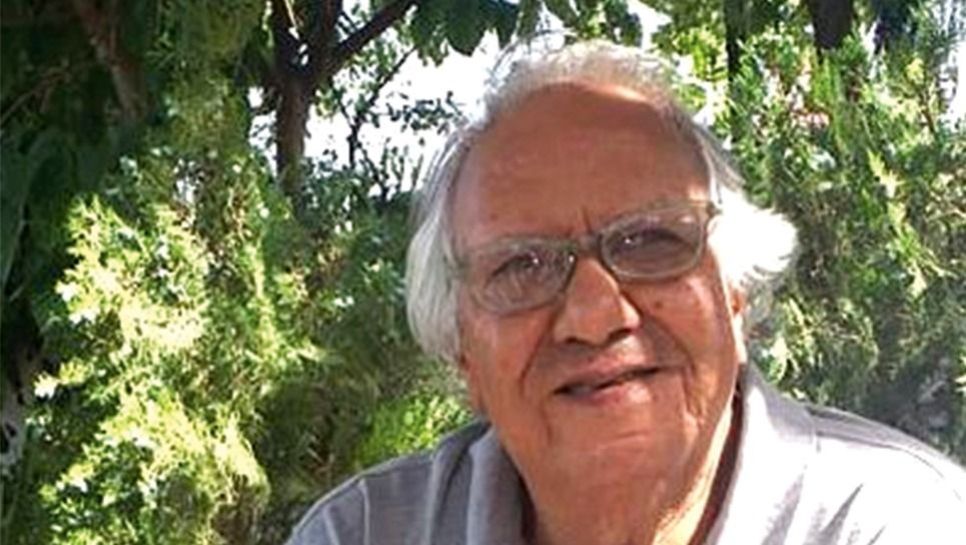
CHRONIQUE de : Rabeh SEBAA
“La plénitude de l’esprit est le seul gage contre la dépravation de la conscience” Jalal Uddin Errumi
Il faut bien se rendre à l’évidence. Nous ne sommes plus dans le registre de la simple délinquance. Il s’agit d’une recrudescence exacerbée durant une période supposée universaliser la sacralité, la convivialité et la solidarité.
Comme dans une bulle. Un bulle intemporelle. Avec ses petites galères. Et ses grandes colères. Avec ses caprices, ses lubies ses fantaisies et son chapelet d'hypocrisies. Un mois à attendre la fin de l'après-midi. Pour revenir à la vie. Et à un semblant de raison. Après des journées entières à lézarder. Et à faire semblant de travailler. Un mois à s'énerver pour des broutilles. Et à supporter toutes les aigreurs et toutes les humeurs. Les massacrées comme les massacrantes. Tous les ressentiments et tous les emportements de ceux qui ignorent tout de la foi. Et qui n’ont jamais croisé la moindre culture de la véritable religion. Mais qui sont les premiers à afficher leur croyance de faussaire avec une harassante ostentation. Sans oser assumer leur encombrante gesticulation. Répercutant invariablement leur impatience exagérée sur leur entourage outré. À commencer par leur famille effarée. Des contrefacteurs de la foi jouant au tyranneau. Au despote du ventre et au tyran de la dentition. Convoquant toutes les saveurs oubliées. Terrorisant toutes les femmes de la tribu. Comme si elles ne vivaient pas le même calvaire elles aussi. Toutes celles qui passent leur journée à s'acquitter dignement de leur tâche. Avant de rentrer pour une seconde journée de travail. Après un détour pour des courses épuisantes dans plusieurs marchés. Des sachets engrossés à trimballer, un transport aléatoire à espérer. Avant d'être coincées entre casseroles brûlantes et marmites débordantes. Le tout arrosé par les sautes d'humeurs d'un mari ou d'un fils braillard qui raisonne par l’intestin et s'exprime par les boyaux. Des tubes digestifs irritables à souhait. Allongés devant la télévision et marmonnant sans arrêt. Demandant. Commandant. Ajoutant. Retranchant. Puis recommandant. Passant tous les plats en revue. Avant une incursion prolongée dans la caverne des senteurs. Une immersion dans l’univers des vapeurs. Pour une inspection intestinale approfondie. Pour des remarques désobligeantes aussi. Et des commentaires déplaisants. Un moment fait d'une suite de remontrances et d'une série de désagréments. Jusqu'au moment du service. Assuré par les femmes évidemment. Le défilé des plats dans l'ordre qui convient. Dans le silence qui sied à l'ingurgitation. Et la solennité lourde de la mastication. Après quoi il reste encore la vaisselle. Les femmes retournent à leur cuisine. Et les hommes à leur espace mâle. Envahi par une foule bigarrée. Pour les processions sans fin, les bavardages et les galimatias de la soirée.
Oubliant que du jour au lendemain, les vols et les agressions atteignent leur point paroxystique. Étrange paradoxe. En cette période qui incline à la piété et à la compassion. À une observance plus stricte des règles religieuses et morales. À un amour plus grand du prochain. Et en guise d’amour du prochain c’est, précisément, le moment choisi pour que la raréfaction des produits de première nécessité devienne proportionnelle à l’emballement de leur prix. La culture de la pénurie, bien ancrée dans les profondeurs immorales, qui fondent celles de la cupidité, se trouve soigneusement orchestrée. Elle refait surface. Impromptument. Poussant brutalement les pauvres mères de famille à un éreintant ballet de paniers. Pour une danse contre les loups. Ces obscurs carnassiers, planqués confortablement dans leur luxuriant herbage et que personne n’ose débusquer. Imposant, impunément, leur loi au marché. Ils font et défont ses mécanismes, déjà amplement déglingués. À leur guise et selon leur insatiable appétit. C’est le moment favori de l’année pour démontrer, non seulement l’absence de toutes formes de solidarité avec leur coreligionnaires, mais pour arracher la peau des fesses de leur rachitique porte monnaie. Pour les forcer à pester contre leur sort sur fond de dévotion. Aussi factice qu’empestée. Aussi décomposée que la mine de toutes celles et ceux qui viennent de plus en plus tôt pour s’entasser devant des hangars lugubres. Où ils s’attableront, en silence, devant un liquide vaguement jaunâtre. Ils ont appris à l’avaler sans se demander si c’est le même que celui de la veille et de l’avant veille. Ils se contentent de le laper. Avec une bonne gorgée de leur amour-propre. Tristes d’être réduits à cette forme de mendicité, avalant une part de ce qui reste de leur dignité. Ils viennent chaque jour, grossir les rangs de la peuplade de la soupe. Il y en a qui sont, depuis longtemps, dans la chaîne. D’autres vont bientôt les rejoindre. Cela va tellement vite. Beaucoup ont déjà perdu leur logement. Les traces de leurs amis. Et les liens de leur famille. Ainsi que toutes les illusions sur les balivernes de l’entraide traditionnelle. Car, à présent, chacun est embourbé dans ses petits sables mouvants. Et ses grands marécages. L’égoïsme est devenu la chose la mieux partagée. Chacun doit se débrouiller. C’est aussi cela l’économie de marché qui a triomphé. C’est aussi cela les nouvelles valeurs de la déferlante bazardante. La déliquescence du lien social. Et la dilution du sens civique. La dislocation de tous les tissus des liens sociétaux cédant le passage à l’individualisme forcené. Un individualisme qui fait le lit de la violence et de l’agressivité. Avec leur lot de vols et d’agressions qui se multiplient à une allure qui donne le tournis. Du jour au lendemain et durant tout ce mois. À toute heure et en tous lieux. Dans les rues, les bus, les marchés, les stations et les quais. Aucun sac, aucune poche, aucun porte-monnaie n’est épargné. Ni la moindre chaîne en or ou le moindre médaillon qui pointe du nez. Des détrousseurs invétérés qui sont, toute la journée, aux aguets. De la première ménagère, déjà, angoissée par la farandole des prix. Ou du dernier pauvre hère complètement sonné par les aléas de la vie et les vertiges de son hypoglycémie. Des pauvres diables qui ont déjà un mal fou à joindre un seul bout de la vie. Et qui sont les victimes toutes désignées de ces pillards sans foi ni loi. Ou plutôt exhibant l’une tout en bafouant l’autre. Des énergumènes qui se foutent complètement de ce que peut bien représenter symboliquement ce mois sacré. Car ces prédateurs endurcis sont les révélateurs caractéristiques d’une société qui souffre d’un dramatique déficit éthique. Une société qui n’arrive pas à transformer en culture, ordinairement partagée, son exubérante religiosité. Passant son temps à clamer haut et fort son excès de moralité. Car il faut bien se rendre à l’évidence. Nous ne sommes plus dans le registre de la simple délinquance. La délinquance ordinaire. La délinquance de tous les jours. Il s’agit d’une recrudescence exacerbée durant une période supposée universaliser la sacralité, la convivialité et la solidarité. Et que cette flambée de violence aggravée contre des gens modestes transforme en funeste banalité. Beaucoup d’entre eux ont perdu, dès le premier jour, la totalité de la somme qu’ils avaient empruntée pour passer leur mois de foi. Se retrouvant encore plus angoissés. Car ils se voient encore plus endettés. Plus embêtés. Souvent blessés, de surcroît. Dépouillés et humiliés. Ils ne savent plus à quelle divinité se vouer.
Ils passeront quelques jours à l’hôpital. Où ils ont le loisir de méditer sur les fondements éthiques de leur société. Malgré l’ouverture de cette parenthèse de bruyante charité. Où toutes les clémences se mettent en théâtralité. C’est la saison spéciale d’exhibitionnisme de toutes les formes d’altruisme et de toutes les espèces d’humanisme. Coulant sous le visage d’un liquide sinistrement jaunâtre. Servi dans des salles humides. Dans une indifférence glaciale. Un liquide insipide mais un prétexte solide. Pour gesticuler. Pour éructer. Pour gigoter et clapoter. Pour faire un bruit du diable. Dans les rues, les journaux, la radio ou ailleurs. Une occasion propice pour une myriade de soi disant associations, se bousculant devant le portillon. Toujours les mêmes d’ailleurs. Qui disparaissent dans la nature et qui reviennent invariablement pour officier durant ce mois. Chacune y va de sa bonté, de son indulgence et son humanité. Et surtout de son fameux couffin de la solidarité. Une invention ridicule. À coups de subventions. Des sommes colossales sont, chaque fois, dégagées. Mais on ne sait jamais qui les gère et où elles vont. Et puis tout s’arrête brutalement. Du jour au lendemain. Plus de soupe. Plus de couffin. Plus de compassion. Plus de charité. Plus de générosité. Plus de bonté. Et pas le moindre mot sur la misère de l’humanité. C’est le silence intégral. Le rideau se baisse lourdement sur les tonitruantes simagrées de tous les faux-monnayeurs de la foi. Qui retrouvent leurs petites habitudes oiseuses. Oublieuses. Comme si durant le reste de l’année ces diables de démunis, qu’on a prétendu choyer, n’ont, subitement, plus besoin de rien. Ni de se nourrir. Ni de s’habiller. Ni de se soigner. Ni de se loger. Ils doivent attendre patiemment onze mois pour se remettre à manger. Onze mois durant lesquels ils ont le loisir de méditer les différents sens de tous les contenus sémantiques du mot jeûner.






